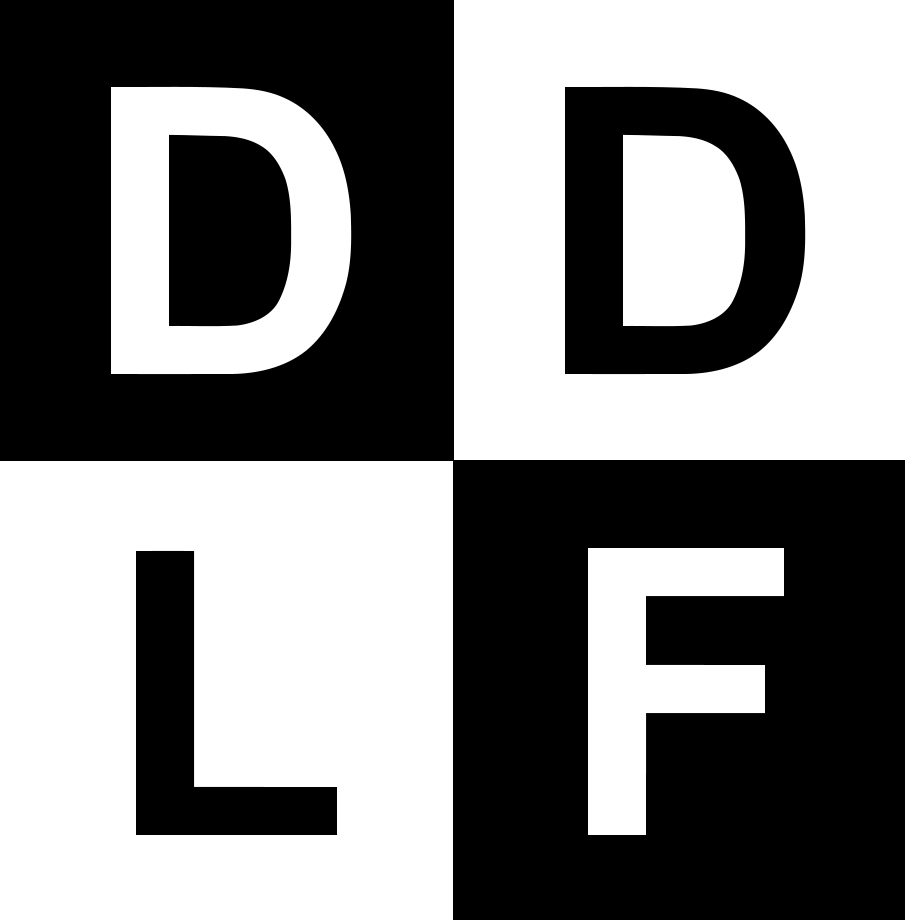prétexte de, que (au) et prétexte de, que (sous) Dans l’usage, il y a parfois une hésitation entre la locution qui commence par au et celle qui commence par sous.
Aujourd’hui, seul sous prétexte de, que est lexicalisé. Dans la dernière édition de son dictionnaire, l’Académie française recommande de préférer sous prétexte de, que à au prétexte de, que. On dira donc :
• Luc ne travaille pas sous prétexte qu’il est doué
plutôt que :
• Luc ne travaille pas au prétexte qu’il est doué.
Si les deux locutions sont très anciennes, au prétexte de, que ne se relève qu’à partir du xviie siècle et dans un contexte juridique[ref]« Et les possesseurs des fonds roturiers ne peuvent pas pretendre d’estre déchargez des tailles & autres impositions, au pretexte de la sterilité desdits fonds […] » (Antoine Despeisses, Traitté des tailles, et autres impositions, 1657, p. 101). « Ainsi un nommé Tros ayant esté esleu Collecteur des impositions du lieu de S. Saturnin le 25. Avril 1633. […] ayant esté appellé à la mesme charge de Collecteur dudit lieu, & pretendant se faire décharger de cette seconde Collecte, au pretexte que lesd[ites] trois années n’estoient pas accomplies ; […] ledit Collecteur fut debouté de l’appellation qu’il avoit interjettée de cette seconde Collecte […] » (ibid., p. 203).[/ref]. Absent de la littérature classique, il commence à devenir fréquent à la fin du xxe siècle.
L’hypothèse selon laquelle le au de au prétexte que aurait été inspiré par celui de au motif que est sans fondement, cette dernière locution étant assez récente.
Sources :
- Académie française, Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., 3 vol., Paris, Imprimerie nationale, Fayard, 1992-2011.
- Despeisses (Antoine), Traitté des tailles, et autres impositions, Grenoble, Chez Jean Nicolas, 1657.